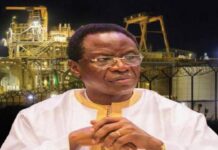Les Africaines, actrices clés de la sécurité alimentaire (2/3). Le secteur agricole représente 30 % des emplois sénégalais, assurés par une majorité de femmes.
A perte de vue, des acacias et des baobabs peuplent la savane poussiéreuse du bassin arachidier, cette large zone d’agriculture pluviale située au centre du Sénégal. Mais à l’approche du village de Tawafal, 120 km à l’est de Dakar, c’est un autre paysage qui attire l’œil du visiteur : six hectares de parcelles verdoyantes plantées d’aubergines, d’oignons, de tomates ou encore de laitues. La zone avait été abandonnée par les hommes en 2017, car pas assez productive, mais les femmes du coin s’y sont accrochées et aujourd’hui 170 d’entre elles en assurent la culture.
« Nos maris sont partis mais nous avons trouvé un accompagnement pour apprendre de nouvelles pratiques agroécologiques bien plus rentables », se félicite Woré Diouf, mère d’une fratrie de huit. Au total, 40 % de ses récoltes sont dédiées à l’autoconsommation, le reste à la vente. « Tout ce que nous consommons vient de nos parcelles. L’argent que j’utilisais avant pour acheter des légumes au marché, je le mets maintenant dans une tontine [système traditionnel d’épargne collective], dans l’école ou la santé des enfants », explique l’agricultrice, qui a également pu investir dans un élevage de poulets.
Au Sénégal, le secteur agricole contribuait à hauteur de 9,4 % au PIB national en 2019, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Un secteur qui représentait 30 % des emplois sénégalais, selon la Banque mondiale. Mais nombreuses sont les femmes à être confrontées à une plus faible productivité que les hommes, faute d’accès à la terre et aux moyens de financement alors qu’elles ont plus d’impact sur les enfants et leur environnement.
« Je suis moins dépendante »
Installée au Sénégal depuis 2009, l’ONG Agrisud International, qui promeut l’agroécologie, a ainsi décidé de miser sur les femmes pour développer un programme d’appui à la diversification maraîchère dans le bassin arachidier. Le projet part d’un constat : durant la saison des pluies, les monocultures d’arachide, de mil et de niébé (variété de haricot très courante en Afrique) s’imposent mais elles sont en pleine chute de production à cause de la sécheresse, de la salinisation des sols et du changement climatique. En tout, quinze sites de maraîchage ont été lancés par l’ONG à travers le pays.
Confrontée à des revenus en baisse, Khady Ngom Djib, agricultrice de 32 ans et mère de deux enfants, a rejoint le projet de Ndérep. Après seulement quelques mois, elle peut manger ses légumes et les vendre dans le village de 11 000 habitants. Son mari lui a acheté les premières semences et paie encore les factures d’eau de la parcelle, mais « je suis moins dépendante de lui. Je peux gérer la maison de façon plus autonome », se félicite-t-elle.
Pour diversifier leurs revenus et participer à la restauration des terres autour de chez elles, les femmes ont aussi planté des arbres fruitiers comme des citronniers, ainsi que des allées de moringa, un arbre aux multiples propriétés médicinales. Ndeye Gningue, une des 123 agricultrices engagées dans le projet, est justement en train de récolter les petites feuilles vertes, qu’elle va ensuite faire sécher et piler pour en faire une sauce. « On le mange avec le couscous, c’est très bon et riche pour nourrir les enfants », précise-t-elle.
Le soutien à l’activité des femmes s’est aussi porté sur l’achat d’un séchoir. Ce jour-là, étalés sur son plateau coulissant, 8 kg de couscous de mil se déshydratent au soleil, protégés du vent par les parois en Plexiglass. « Avant je laissais les céréales ou le moringa sur une table dans ma chambre mais ce n’était pas hygiénique, entre la poussière, les enfants et les poules qui entrent dans la pièce, explique Khady Ngom Ablaye Diack. Et puis cette nouvelle technique conserve plus longtemps les aliments, qui gardent leurs valeurs nutritives. »
Investir dans le renforcement de compétences des femmes rurales et leur donner accès à du matériel a aussi pour objectif de réduire leur départ vers les grandes villes où elles vont chercher de quoi compenser la perte de revenus issus des grandes cultures d’arachide, due au manque d’eau et à l’appauvrissement des sols causés par le changement climatique et la surexploitation des terres. « Elles peuvent maintenant gagner leur vie en travaillant sur place, ce qui leur permet à la fois d’encadrer les enfants à l’école, mais aussi de contribuer à la sécurité alimentaire de leur village », explique Louis-Etienne Diouf, chef de projet à Agrisud.
Biofertilisants maison
Les femmes sont aussi, selon lui, davantage réceptives au tournant vers l’agroécologie, ces méthodes qui se veulent respectueuses de l’environnement pour garantir une production plus durable et nourrissante sur le long terme. Les agricultrices ont par exemple appris à confectionner des biofertilisants à partir de feuilles de neem et de leucaena, d’ail ou de piment. Dans chaque parcelle, le compost recyclé a remplacé les engrais chimiques.
Une attention aux pratiques alternatives qui s’explique aussi par leur impact sur leur propre mode de vie. « Le fardeau du changement climatique repose sur les femmes, fait remarquer Thérèse Mbaye, chargée de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles au sein du Réseau national des femmes rurales du Sénégal, qui regroupe une centaine d’organisations. Ce sont elles qui se démènent à chercher à manger quand les sols sont appauvris, qui sont responsables des enfants qui tombent malades à cause de la pulvérisation de pesticides dans les champs, ou qui s’occupent de ramasser les déchets organiques et fumiers quand elles balaient la cour de leur maison. »
La militante observe d’ailleurs que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les comités villageois ou les conseils municipaux pour défendre leurs droits et développer leurs communautés. Au cœur de la gestion du foyer, elles ont tendance à investir leur argent dans la nourriture, la scolarité, la santé des enfants, ou à mettre de côté en cas de problème. « Alors que les hommes vont le dépenser pour leurs besoins personnels », continue la militante, dont l’autre combat est l’accessibilité au foncier pour les femmes afin d’y pratiquer l’agroécologie.
Avec lemonde.fr