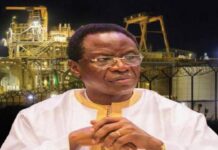La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) a profité d’un atelier de partage des résultats de ses études sur les ressources en eau réalisées entre 2017 et 2019 le 27 mai dernier à Diamniadio, une ville située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar et organisé par le ministère de l’Eau et de l’Assainissement à travers l’institution citée plus haut pour mettre en exergue les problématiques de l’eau et des politiques publiques menées jusqu’ici dans le secteur mais aussi les diverses menaces qui pèsent sur ce domaine. Lors de cette rencontre, les participants ont également lancé la phase 2 du Plan d’action de gestion intégrée des ressources en eau 2018-2030 (Pagire II).
Différentes ont été révélé lors de cette cérémonie à savoir l’étude portant sur l’actualisation du Plan d’action et de gestion intégrée des ressources en eau (Pagire phase 2), l’étude hydrogéologique de la nappe des sables alluvionnaires entre Bakel et Kidira et l’étude hydrologique de la Falémé dans la zone de Kidira, l’étude hydrogéologique et hydrologique pour déterminer les potentialités de l’alimentation en eau de Kédougou et ses environs, l’étude d’évaluation des potentialités des ressources en eau en vue d’alimenter la zone de Cap skiring, l’étude hydrogéologique et hydrologique complémentaires de la nappe continentale de la zone Sine-Gambie, l’étude d’évaluation des potentialités des ressources en eau du plateau d’Oussouye, et l’étude hydrogéologique complémentaire du système du Horst de Diass (nappes du Paléocène et du Maastrichtien).
Si l’on se fie à la DGPRE, ces études sont financées par l’Agence belge de développement (Enabel). Elles ont pour dessein à mieux faire connaître la ressource en eau en vue d’une exploitation durable. Elles se sont basées sur un important volet d’investigations géophysiques qui a permis de mieux affiner la géométrie des formations géologiques et des potentiels aquifères.
« L’accroissement de la population augmente contribue largement à la hausse de la demande en eau et les risques de surexploitation des plans d’eau de surface et des nappes d’eau souterraines. La baisse de la pluviométrie, qui entraîne une réduction de la recharge des nappes, la baisse des niveaux d’eau dans ces nappes souterraines, ce qui provoque le tarissement des cours d’eau. C’est ce dont ont fait état des études récentes sur les ressources en eau », a détaillé la structure devant un parterre d’experts.
«Même si l’on peut considérer que les quantités d’eau disponibles dans les masses d’eau répertoriées sont encore suffisantes pour satisfaire les besoins en eau du pays (3000 à 4500 m3/habitant et par an), cette ressource ne doit pas être considérée comme acquise et nécessite de réaliser régulièrement un suivi des niveaux de nappe et de la qualité des eaux souterraines mais aussi des eaux de surface», précisent les experts de la DGPRE. Pour ces études accueillies avec enthousiasme, «une attention particulière devra être apportée aux remontées salines qui ne doivent pas contaminer la nappe de manière irréversible.»
Le secteur agricole n’a pas été occulté à l’occasion de cette cérémonie. Occasion saisie par la DGPRE pour dénoncer l’utilisation « peu maîtrisée » des pesticides et des engrais chimiques dans la mise en valeur agricole des terres contribuant à la dégradation de la qualité des ressources en eau de la zone, de même que le développement de pratiques culturales faiblement économes en eau. Or, les ressources en eau souterraines sont partagées avec d’autres régions du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau, et le prélèvement intensif dans certaines zones à fort potentiel ne doit pas engendrer une pénurie d’eau dans leurs régions limitrophes.
Pour pallier ces multiples disfonctionnements afin d’assurer une meilleure gestion intégrée des ressources hydrauliques, les auteurs de ces études recommandent « le renforcement du réseau de suivi des eaux de surface et souterraines, de la valorisation des résultats par les usagers notamment la Sones et l’OFOR pour assurer l’alimentation en eau potable des populations de manière efficiente et durable, une meilleure concertation des structures et programmes du ministère et de ses partenaires dans l’élaboration des projets d’exploitation de la ressource, et une large diffusion des résultats de ces études ».
S’agissant du Programme d’actions prioritaires couvrant la période 2018-2030, 26 actions prioritaires ont été identifiées pour un budget estimé à 310 milliards 51 millions de francs CFA. Le coût de la première phase (2018-2025) est estimé à plus de 120 milliards et le montant de la seconde phase (2026-2030), quant à lui, est estimé à plus de 250 milliards de francs CFA.
Moctar FICOU / VivAfrik