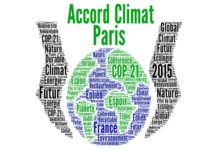Khaled IGUE, Manager au sein du cabinet Eurogroup Consulting et Président du Think Tank Club 2030 Afrique, fait l’état des lieux de la situation énergétique en Afrique dans cette interview accordée à VivAfrik.com. Partant du constat que le développement économique soit énergivore, M. Igué estime qu’il ne faudrait pas moins de 50% du fond vert des Nations Unies pour une révolution énergétique décarbonée en Afrique.
VivAfrik : Quelle est l’importance de l’énergie pour l’Afrique ? Et quel état des lieux faites vous de la situation ?
Khaled IGUE : Le continent africain comptera plus de deux milliards d’habitants d’ici une trentaine d’années. Ce boom démographique sans précédent confronte l’Afrique au défi majeur du développement d’une énergie durable, dont les fondements permettront d’accompagner sa transformation économique, tout en intégrant les préoccupations environnementales de la planète. Le constat est d’autant plus accablant pour un continent qui concentre 15% de la population mondiale mais représente seulement 3% de la demande mondiale en énergie primaire.
Cette faible consommation constitue un véritable frein à son « décollage » économique, mais aussi social. L’accès à l’électricité est indispensable pour sortir le continent africain de la pauvreté et améliorer ses infrastructures de santé et d’éducation. Il y a urgence : l’Afrique doit définir une politique énergétique qui lui permette de s’engager sur le chemin d’une croissance durable.
40% de la population africaine a accès à l’énergie. Ce constat masque cependant de fortes disparités énergétiques : sur le plan régional, seulement 30 % de la population africaine vit en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, mais ces deux régions représentent à elles seules 80% de l’énergie consommée par l’ensemble du continent. L’Afrique souffre aussi d’une très faible électrification : La situation est très variable selon les régions. Si l’électrification de l’Afrique du Nord est presque achevée (taux d’électrification de 99 %), l’Afrique subsaharienne reste très peu électrifiée, avec un taux d’électrification proche de 32 %.
VA : Quel est l’impact du déficit énergétique de l’Afrique sur son développement ?
KI: Le manque d’accès à l’énergie moderne entrave sérieusement le développement économique et social du continent. L’Afrique subsaharienne enregistre le plus important taux d’utilisation de combustibles solides traditionnels pour la production d’énergie notamment pour la cuisson des aliments. Ces sources d’énergie présentent des effets nocifs importants sur la santé. Malheureusement, ce sont les segments les plus pauvres des populations qui paient le plus lourd tribut par l’utilisation des ressources énergétiques non convenables. Le manque d’accès aux services énergétiques modernes constitue également un obstacle au développement des entreprises et à l’expansion d’autres opportunités. Ce manque d’accès à l’énergie moderne affaiblit la compétitivité, et ne facilite pas l’accès des producteurs de différents pays aux marchés régionaux et mondiaux. Il représente un facteur majeur du ralentissement de la course de du continent vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
VA : Quel est l’avenir des énergies fossiles en Afrique ?
KI: En 2012, l’électricité en Afrique subsaharienne était principalement générée à partir de charbon (56 % du mix électrique) et d’énergie hydraulique (22 %). Le mix électrique en Afrique subsaharienne sera bien plus diversifié en 2050 qu’en 2012. Ainsi, dans chacun des scénarios élaborés par différentes instituions comme l’IAE, la CME etc, aucune énergie ne comptera pour plus de 35 % du mix électrique.
Parmi les énergies fossiles, les différents scénarios ont des conclusions similaires : le charbon et le pétrole verront leur part décliner, tandis que le gaz deviendra un des piliers du mix électrique subsaharien.
Concernant le charbon, sa part dans le mix énergétique devrait baisser continuellement entre 2012 et 2050 : de 56 % en 2012, sa part dans le mix énergétique passera à 22 % en 2050 selon les calculs effectués par l’ADEA en se basant sur le scénario « New Policies » de l’AIE (la baisse est plus rapide dans le scénario « African Century Case », avec une part de 18 %). En 2050, le CME prévoit une part comprise entre 14 % et 16 % selon le scénario considéré.
Le pétrole devrait à terme être beaucoup moins utilisé pour la génération électrique : les projections 2050 réalisées par l’ADEA indiquent que sa part dans le mix déclinera, atteignant 3,5 % en 2050 dans les deux scénarios de l’AIE (contre 9 % en 2012). Le CME est lui plus catégorique, et prévoit que, à l’horizon 2050, le pétrole ne sera plus utilisé pour générer de l’électricité, et ce dans ses deux scénarios.
Le gaz devrait occuper une place de plus en plus importante dans le mix électrique subsaharien. Si seulement 40 TWh sont générés grâce à des centrales aux gaz en 2012 (9 % de l’électricité générée), cette quantité devrait atteindre, en 2050, 664 TWh selon l’extrapolation ADEA basée sur le scénario « New Policies » de l’AIE (30 % du mix), et près de 950 TWh en considérant le scénario « African Century Case » (31,5 %).
VA : Comment l’Afrique pourrait-elle se développer qu’à base d’énergies renouvelables ?
KI: Le mix énergétique en 2050 reposera toujours principalement sur les énergies fossiles. Même si leur importance relative diminue, elle reste très supérieure à celle des énergies renouvelables. Les énergies fossiles représentent entre 49 % et 80 % de la demande en énergie primaire totale (contre 82 % en 2012).
L’énergie hydraulique garde dans tous les scénarios une importance limitée dans le mix énergétique mondial de 2050 (moins de 5 %). Enfin, la part des énergies renouvelables (hors énergie hydraulique : biomasse, éolien, solaire, géothermie…) dans le mix énergétique augmente : elle atteindra entre 13 et 34 %, contre seulement 11 % actuellement.
La COP 21 faisant effet de levier, la part des énergies renouvelables pourraient accroître considérablement avec le mécanisme d’aide mis en place. En effet avec l’évolution de la technologie, les centrales solaires et à biomasse pourraient contribuer à la révolution énergétique en Afrique favorisant une part plus importante des énergies renouvelables dans le mix énergétique africain.
VA : Nous sortons de la COP21, quel bilan faites-vous des négociations en ce qui concerne l’Afrique en général, de la finance climatique en particulier, et plus spécialement du financement de la transition énergétique ?
KI: Le financement est un point crucial de l’accord. Sans financement, il est impossible d’aider les pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique. L’Afrique fait cas d’école : le continent émet moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre et il est aussi le plus touché par le réchauffement climatique. Plus accablant, le continent ne consomme que 3% de l’énergie mondiale produite. La faible consommation d’énergie est un réel frein pour le développement économique des pays africains. Si l’on part du principe que l’Afrique est le prochain relais de croissance et pourrait devenir le premier continent à faire une révolution énergétique décarbonée, il convient de lui consacrer au moins 50% du Fond vert des Nations Unies pour développer des projets d’énergies renouvelables.
L’équation n’est pas aisée pour le continent africain. D’une part, il doit se développer économiquement donc mener une politique énergétique ambitieuse et d’autre part, il doit développer une politique énergétique décarbonée. Il faudrait que l’Afrique bénéficie d’une réelle incitation, avec un mécanisme de financement adéquat pour accompagner les 6 000 projets d’énergies renouvelables qui peinent à voir le jour par manque de financement ou de garantie financière.
Le financement des efforts des pays en développement était un autre point d’achoppement des discussions : l’objectif de $ 100 milliards par an d’ici 2020, à fournir par les pays développés, adopté en 2009 au Sommet de Copenhague, est présenté comme « un niveau plancher » avec un objectif à définir pour après 2025.
Et maintenant?
Tout d’abord, jusqu’en 2020, c’est le protocole de Kyoto qui continue à s’appliquer. L’accord de Paris, adopté en séance par consensus, doit maintenant être signé (probablement au début de l’année 2016). Puis pour entrer en vigueur le 1er janvier 2020, puis il devra être ratifié, accepté ou approuvé, selon les modalités retenues par chaque Etat, par au moins 55 pays représentant au moins 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais, « à tout moment après un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord pour un pays », celui-ci pourra s’en retirer, sur simple notification.
Propos recueillis par Mahamadou BALDE