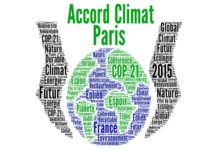Il y a d’abord eu la grande sécheresse du début des années 70. Puis le phénomène s’est banalisé. Les pluies sont devenues plus rares et, surtout, imprévisibles. « Aujourd’hui, on peut recevoir en un après-midi autant d’eau de pluie qu’on en recevait en une saison il y a 20 ans », constate, amer, Marius Dia, coordinateur du Cncr (Conseil national de concertation et de coopération des ruraux) au Sénégal. Le changement climatique, ce sont d’abord les agriculteurs, les pêcheurs ou les éleveurs qui en paient le prix fort en Afrique, et en particulier dans la zone sahélienne, explique-t-il dans sen360.com samedi dernier et lu par vivafrik.com.
Dans la région des Hauts-Bassins, à l’ouest du Burkina Faso, le producteur de maïs et de sorgho Bassiaka Dao accuse le coup. Il raconte les rendements en berne avec cette « pluie qui ne tombe jamais au bon moment », les stocks de semence qui s’épuisent à force de semer et ressemer, la recrudescence des maladies et des ravageurs, les terres de moins en moins fertiles. Pour autant, il ne s’estime pas si mal loti, avec ses quelque 1 000 mm de pluie annuels. Au nord du pays, la pluviométrie est deux fois plus faible. « Là -bas, tous les agriculteurs se déplacent vers la Côte d’Ivoire et le Ghana, car ils n’arrivent plus à produire sur leurs terres », observe, dépité, celui qui préside aussi la confédération paysanne du Faso. Et d’indiquer que « 86 % des emplois sont des métiers agricoles au Burkina Faso ».
L’agriculture familiale, pierre angulaire de l’économie et de l’écologie
Plus généralement, en Afrique de l’Ouest, le secteur agricole emploie environ 60 % de la population active et contribue jusqu’à 35 % du Produit intérieur brute (Pib) selon le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Cgiar). La COP21 représente ainsi pour les leaders paysans africains un enjeu crucial. Ils viennent y défendre leur vision de l’agriculture de demain, à des lieues du modèle de la révolution verte et de son paquet technologique incluant notamment engrais et pesticides. À Paris, Bassiaka Dao fait partie de la délégation officielle burkinabé. Il représente aussi le Roppa (Réseau des organisations paysannes et des producteurs d’Afrique de l’Ouest), dont il est administrateur.
En matière de développement agricole, ce réseau consacre une place centrale à l’agriculture familiale, caractérisée par de petites exploitations de 1 à 2 hectares. Elles s’avèrent vitales dans les économies de la sous-région. Au Sénégal, on en dénombre environ 50 000 et elles assument 95 % de la production alimentaire nationale, selon le Cncr. Face au triple défi de nourrir une population croissante, de juguler la pauvreté dans les campagnes et de protéger l’environnement, elles font aujourd’hui figure de pilier dans les lois agricoles du Mali, du Niger ou du Sénégal. « Les rendements des petits producteurs peuvent encore augmenter si on améliore les services, la professionnalisation et la commercialisation », précise Marius Dia. Mais surtout, plaide-t-il, « l’agriculture familiale est la seule agriculture qui préserve les ressources naturelles ».
L’agro écologie, une solution de long terme
Produire plus, dans des écosystèmes affectés par le changement climatique… Les organisations paysannes ont dû accorder leurs violons sur les mesures à défendre lors de la COP21. « La question prioritaire sur laquelle on est parvenus à un consensus au niveau panafricain est celle de l’adaptation, qui nécessite des financements et des transferts de technologies », explique Mamadou Goïta, directeur exécutif de l’Irpad (Institut de recherche et de promotion des alternatives au développement) au Mali, qui rappelle que l’Afrique émet seulement 3 % des émissions de CO2 mondiales. Il s’agit ensuite, selon ce chercheur militant, de favoriser l’agro écologie et ses méthodes culturales (engrais organiques, diversité des cultures), qui non seulement contribuent à atténuer les émissions de CO2, mais se révèlent également moins coûteuses pour les paysans. Le recours aux approches agro écologiques est également défendu par la Fao, l’agence de l’Organisation des Nations unies (Onu) pour l’alimentation et l’agriculture, dont le représentant au Sénégal Vincent Martin observe qu’elles ont pu avoir « un impact sur les rendements tout en préservant l’environnement ». « L’enjeu de la COP21 consiste à opérer un changement de paradigme, car les visions à court terme ne sont plus acceptables en ce qui concerne le climat et ce que peut offrir l’agriculture », ajoute-t-il.
Divergences sur le rôle de l’agrobusiness
Aujourd’hui impliquées dans l’élaboration des politiques agricoles auprès de leurs gouvernements et des institutions régionales, les organisations paysannes africaines pourront-elles faire entendre leur voix à la COP21 ? Nombre de leurs représentants évoquent leur déception à l’issue de la conférence de 2009 sur le climat à Copenhague. « On avait déjà décidé de mettre l’accent sur l’agriculture familiale, mais nos Etats se sont rués dans la course à l’agrobusiness », déplore Marius Dia. La part de l’ « agrobusiness » dans le développement agricole reste aujourd’hui encore un point très discuté entre le Roppa et la Cedeao (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest). « On ne veut plus de pesticides et de produits chimiques », tranche Bassiaka Dao. Dans sa politique agricole (Ecowap) adoptée en 2005 ou son plan régional d’investissement agricole (Pria), la Cedeao promeut l’agriculture familiale mais aussi les entreprises agricoles grâce à la participation du secteur privé. « L’agrobusiness peut contribuer au développement des communautés rurales, à condition qu’il y ait une implication totale des populations locales et des retombées positives en matière d’emploi et d’accès à la terre et à l’eau », nuance Vincent Martin. Quant au fait d’être davantage entendu à Paris qu’à Copenhague, Bassiaka Dao affiche l’optimisme : « Les engagements devront être mis en œuvre cette fois, nous n’avons plus le choix. Le monde entier est témoin des différentes crises, alimentaires, économiques, des migrations. » Aboutir à des solutions concrètes après la COP21 et rendre la vie du monde rural plus digne, ces responsables paysans y veilleront.
Moctar FICOU VivAfrik