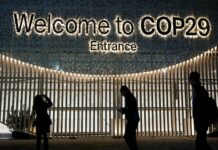Ecosur Afrique leader du crédit carbone en Afrique vient de réaliser avec succès une première transaction dans le marché intra-africain. Cette opération est doublement salutaire, car non seulement elle a été un succès, mais aussi elle lance un signal fort allant dans le sens d’un échange Sud-Sud de crédits carbone. Fabrice Le Saché interviewé par VivAfrik.com explique que ce leadership est le fruit d’une lutte acharnée dans un terrain complexe au moment où ses principaux concurrents ne misaient que sur les pays émergents tels que le Brésil, la Chine, l’Inde,… minimisant le potentiel de l’Afrique. Ecosur Afrique veille aujourd’hui à ce que toute émission de gaz à effet de serre évitée en Afrique soit valorisée, en proposant un accompagnement à tout projet potentiel. Interview Intégrale :
VivAfrik : Pouvez-vous nous faire l’historique de la finance carbone en Afrique ?
Fabrice Le Saché : La finance carbone est née dans le sillage de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en 2005. Cet accord international ouvre la possibilité pour les Etats industrialisés de respecter une partie de leurs engagements de réduction d’émissions CO2 en ayant recours à l’achat de crédits de carbone provenant de projets situés dans les pays en développement. Un véritable marché d’échange de crédits de carbone se crée ainsi dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) administré par l’ONU. Partant du principe qu’une tonne de CO2 évitée à Dakar ou à Paris a le même effet et que l’achat de crédits de carbone aide les pays en développement à s’équiper en technologies vertes, la communauté internationale utilise les mécanismes de marché pour juguler les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 10 ans, 7 500 projets MDP ont été enregistrés – cela comprend des projets d’énergies renouvelables, de traitement des déchets, de substitution de combustible, d’efficacité énergétique – mais seulement 3% en Afrique. Sur le continent, quelques pays pionniers se sont saisis de cette opportunité. L’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, le Kenya, l’Ouganda ont ainsi tiré parti de la finance carbone. Ils ont été rejoints plus tardivement par de nombreux autres. Une dynamique positive s’est instaurée depuis 2012 mais a été brisée par la chute des cours en 2013. Nous continuons pourtant à croitre et à développer de nouveaux projets car cette situation de marché est paradoxalement favorable pour le continent. Seuls les acheteurs volontaires, ceux qui souhaitent soutenir des projets en dehors de toute obligation réglementaire, perdure, hors cette typologie d’acheteur a une prédilection pour les projets situés dans des pays africains qui présentent des co-bénéfices et une valeur ajoutée sociale importants.
VA : Parlez nous de vos premiers pas en Afrique, et comment en si peu de temps (depuis 2009) Ecosur Afrique dont vous êtes le PDG s’est imposé en leader sur le marché africain ?
FLS : J’ai amorcé mes activités dès 2006 et je puis vous assurer que presque 10 ans de marché du carbone ne m’ont pas semblé si courts ! En vérité, la construction de ce que vous percevez aujourd’hui a constitué un travail de longue haleine, une succession de projets, contrats, soubresauts, que je vous épargne, mais qui ne nous ont pas été épargnés. Seule une persévérance absolue conjuguée à une charge de travail absorbée par une équipe de collaborateurs particulièrement réactive et efficace nous ont permis de construire et consolider un leadership. Peut-être aussi faut-il rappeler que nous sommes l’un des premiers acteurs de notre secteur à nous être intéressés à l’Afrique. Nos principaux concurrents absorbés par la Chine, l’Inde et le Brésil considéraient l’Afrique comme une zone complexe à faible opportunité. Complexe cela l’a été car dans de nombreux pays nous avons essuyer les plâtres, pour parler quelque peu familièrement. Nous avons ainsi été la première société à enregistrer une activité MDP dans 9 pays africains. Le caractère pionnier mérite d’être souligné car cet effort a permis de tester les procédures et de fluidifier celles-ci pour les porteurs de projets suivants. Quant à la prétendue faible opportunité, nos concurrents se sont lourdement trompés sur les gisements de projets qui existent en Afrique. A trop être concentré sur des sites industriels on oublie que les technologies qui concernent les populations peuvent être également des vecteurs de réductions CO2, l’Afrique recèle en la matière de ressources significatives.
VA : Le crédit carbone peut-il intéresser les petits émetteurs de CO2 (sous forme de coopérative par exemple), les industries atteignant une taille critique avec fort potentiel d’émission de gaz à effet de serre n’étant pas la prédominance en Afrique? Est-ce que le portefeuille d’Ecosur Afrique comprend des unités industrielles à taille humaine ?
FLS : Il existe un secteur industriel africain qu’il convient de ne pas sous-estimer car des gisements de réduction CO2 importants existent. Je pense aux brasseries, aux cimenteries, aux industries minières, aux champs pétroliers, aux agro-industries, aux centrales de production électriques entre autres. Outre les géants industriels, le tissu de petites et moyennes entreprises peut bénéficier de la finance carbone : un exemple très concret serait le remplacement de générateurs diesel par des ressources énergétiques alternatives (solaire, éolien, biomasse, hydroélectricité). Des coopératives ou groupements de société civile peuvent aussi accéder à ce marché : une coopérative active dans le traitement des déchets qui produirait du compost par exemple. Nos clients sont de toutes tailles allant de la start-up à la multinationale. Nous travaillons également pour le secteur publique – entreprises d’Etat, collectivités locales – ou pour des initiatives citoyennes, fondations, associations notamment.
VA : La conférence de Paris (COP21) peut-elle impulser les bases d’un référentiel mondial unique du prix du carbone incluant des prédispositions particulières pour les crédits carbone africains ?
FLS : Je ne crois pas qu’il soit possible d’instituer un prix du carbone unique. Ce serait comme vouloir instituer une monnaie unique à l’échelle mondiale sans aucune coordination préalable des politiques économiques. Un prix du carbone n’a de sens que dans des écosystèmes comparables. Il faut que ce prix corresponde à un signal déclenchant une obligation d’innovation. Un prix du carbone de 5 EUR/tonne en Europe ne produirait aucun effet incitatif au changement. Ce même prix permettrait de déclencher des centaines de projets en Afrique pour certaines technologies. Je crois néanmoins qu’il est possible et souhaitable de minimiser la fragmentation du marché actuel. Chaque pays ou bloc régional crée son infrastructure. Il faut qu’existent des passerelles, des possibilités pour que la tonne CO2 soit dans une certaine limite et sous certaines conditions fongibles entre les systèmes sans quoi nous ferons face à des problématiques de liquidités et potentiellement à des krachs à répétition sur certains segments de marché qui ne disposeront pas d’une profondeur volumétrique suffisante. S’agissant du continent africain nous proposons un prix plancher minimum de 5 EUR/tonne garanti par l’ONU. Ce signal prix serait de nature à conforter de nombreux projets de réduction CO2 sur le continent. Les investisseurs pourront d’autant mieux réaliser leurs projets qu’une sécurité sur les revenus du carbone existe.
VA : Quel est le niveau d’implication des places boursières africaines dans les transactions sur les crédits carbone ? Dans quels marchés Ecosur Afrique détenteur du premier portefeuille africain de crédits carbone opère t-il ? Pourquoi ?
FLS : Il n’existe pas à proprement parler de bourses du carbone ou de marché organisé africain traitant les crédits carbone. Les échanges sont structurés par voies contractuelles et les transactions sont exécutées de gré à gré au comptant ou à terme. Historiquement les crédits carbone africains sont commercialisés en Europe principal pôle de demande et débouché international. Nous avons évidemment commercialisé la quasi totalité de nos volumes, 30 Mio de tonnes, dans ce cadre. Nous avons néanmoins décidé d’amorcer des transactions intra-africaines en générant une demande d’entreprises locales. Il s’agit d’un axe majeur de développement ; nous pensons que la valeur ajoutée se situera dans les flux sud-sud ces prochaines années en raison de nouvelles réglementations et de nouvelles pratiques des opérateurs économiques.
VA : Avez-vous lu Jaques Mistral dans « Le climat va-t-il changer le capitalisme ? » ? Dans tous les cas, qu’en pensez-vous et quel rôle attribuerez-vous à l’Afrique dans l’échiquier mondial de la régulation des émissions de gaz à effet de serre ? Quel poids, quel pouvoir, et surtout quelle stratégie ?
FLS : Je n’ai pas lu cet ouvrage mais, s’agissant de l’Afrique, je crois que ce continent a un rôle primordial à jouer. Il nous rappelle tout d’abord à nos obligations morales. Faut-il le souligner, la responsabilité historique des émissions de gaz à effet de serre incombe aux pays dits développés et l’Afrique est une des premières victimes des conséquences du réchauffement planétaire : raréfaction des ressources en eau, modification des sols agricoles, migrations internes incontrôlées, nombreuses sont les conséquences directes qui affectent la vie des habitants et des entreprises africaines. Je crois néanmoins que l’adaptation à laquelle le continent est contrainte est également source d’opportunités. Elle permet à la société civile, aux gouvernements, aux entreprises d’envisager des solutions de développement qui empruntent des chemins différents des économies occidentales. Elle permet une pleine expression de l’innovation et je suis convaincu que l’Afrique exportera des modèles économiques nouveaux, des produits et services dans les autres régions du monde. Comme indiqué précédemment, le continent recèle de nombreuses opportunités de réduction des émissions CO2 et dispose de réserves de carbone importantes. Les pays africains disposent donc d’un actif précieux et valorisable mais le groupe Afrique pèse peu dans les négociations internationales, et à vrai dire peu d’Etats ont un poids réels qu’ils soient africains ou non. Quelques superpuissances déterminent les lignes de force. Les discussions climatiques Etats-Unis/Chine sont une illustration frappante. Il y a une certaine fiction onusienne reconnaissant un poids égal à chaque Etat. La puissance économique est un point clé. Néanmoins, les forces d’appoint peuvent influencer. C’est le cas du groupe Afrique si il est uni. Des efforts importants de coordination sont menés en ce sens mais bien évidemment le consensus n’est pas toujours la voie d’avancement la plus rapide. La stratégie pour être efficace doit être simple et lisible : réduction des émissions CO2 en Afrique contre une valorisation financière claire et directe de cet effort. Chaque tonne CO2 évitée sur le sol africain doit ouvrir droit à rémunération. C’est bien le moins que la communauté internationale puisse faire. Il ne s’agit pas de quémander, c’est un dû au regard des désastres provoqués par un fait générateur extérieur au continent.
Propos recueillis par Mahamadou BALDE
>> Pour en savoir plus, VivAfrik vous propose les encadrés suivants :
> Encadré 1 : Qu’est-ce que le crédit carbone, et comment ça marche en Afrique ?
Un crédit de carbone correspond à une tonne d’émission CO2 évitée dans l’atmosphère. L’évitement des émissions CO2 est réalisé grâce à la mise en œuvre de projets verts tels que la production électrique à partir de ressources renouvelables, l’efficacité énergétique, le traitement et valorisation des déchets, le remplacement d’énergie polluante par des ressources moins émettrice de CO2 (remplacement de charbon par du gaz par exemple). Tout développeur de projet africain développant un projet vert peut inscrire celui-ci au sein de l’ONU pour bénéficier de crédits de carbone dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP). Une fois le projet enregistré, les crédits de carbone sont délivrés après vérification annuelle, et les revenus ainsi générés contribuent à améliorer la profitabilité du projet et donc à accélérer le transfert de technologies vertes en Afrique.
> Encadré 2 : l’essentiel de la société Ecosur Afrique de 2009 à 2015
 Ecosur afrique est un groupe fondé en 2009 à Maurice spécialisé dans la finance climatique en Afrique. L’ensemble des activités vise à générer des revenus par la réduction des émissions CO2 sur le continent. Ecosur afrique accompagne +40 projets dans 17 pays africains et dispose du 1er portefeuille de crédits de carbone africain. Le groupe a commercialisé près de 30 Mio de tonnes de crédits carbone et enregistré 25 projets auprès de l’ONU, un record à l’échelle de l’Afrique. Ecosur afrique déploie ses activités à partir de Maurice, Abidjan, Kinshasa et Bruxelles. Le groupe compte 61 collaborateurs pour un CA 2015 estimé à 10 Mio EUR réalisé en trois pôles d’activité : le conseil, l’investissement et le négoce.
Ecosur afrique est un groupe fondé en 2009 à Maurice spécialisé dans la finance climatique en Afrique. L’ensemble des activités vise à générer des revenus par la réduction des émissions CO2 sur le continent. Ecosur afrique accompagne +40 projets dans 17 pays africains et dispose du 1er portefeuille de crédits de carbone africain. Le groupe a commercialisé près de 30 Mio de tonnes de crédits carbone et enregistré 25 projets auprès de l’ONU, un record à l’échelle de l’Afrique. Ecosur afrique déploie ses activités à partir de Maurice, Abidjan, Kinshasa et Bruxelles. Le groupe compte 61 collaborateurs pour un CA 2015 estimé à 10 Mio EUR réalisé en trois pôles d’activité : le conseil, l’investissement et le négoce.
A titre illustratif voici ci-dessous en images la réalisation d’Ecosur Afrique en République Démocratique du Congo. Jiko Mamu est le plus gros investissement d’Ecosur Afrique. C’est une usine qui produira à terme 10 000 foyers améliorés à charbon de bois industriel : la plus grande d’Afrique centrale. Ecosur Afrique a acquis le site, construit les hangars, développé le modèle, recruté 30 ouvriers, etc.
> Encadré 3 : Qui est Fabrice Le Saché ?
 Fabrice Le Saché est le fondateur et Directeur Général d’ecosur afrique, groupe spécialisé dans la finance climatique sur le continent africain. Diplômé en Droit International (LL.M San Diego School of Law, Université Paris II Panthéon-Assas), il crée à la fin de ses études, en 2006, la société ecosur spécialisée dans la finance et stratégie carbone en France. A partir de 2008, il engage un développement vers l’Afrique, marché alors considéré comme restreint pour les crédits carbone et fonde en 2009 ecosur afrique, groupe qui implantera des bureaux à Port-Louis, Abidjan, Kinshasa et Bruxelles. En quelques années, il constitue le 1er portefeuille de projets carbone d’Afrique (40 projets dans 17 pays), travaille avec des grands comptes continentaux (SIFCA, CSS, Géocoton, CIE, VRA, Hysacam, Zoomlion, Sococim,…) et les premiers acheteurs mondiaux de crédits carbone (Vitol, Cargill, Bunge, Shell Trading, Standard Bank, EDF Trading..). Le groupe devient le 1er négociant de crédits de carbone en Afrique subsaharienne et enregistre un nombre record de projets africains à l’ONU (25). En 2012, Fabrice Le Saché fonde ecosur investment, véhicule visant à acquérir des participations dans start-ups vertes africaines et ecosur trading afin de mieux valoriser les actifs carbone africains sur les marchés internationaux. Il est également à l’origine d’un plaidoyer visant à réorienter la finance carbone vers l’Afrique. L’initiative connue sous le nom de MDP-Afrique rassemble les signatures de 40 hauts dirigeants d’entreprises actifs sur le continent. Fabrice Le Saché s’investit également dans des actions de la société civile, notamment la mobilisation des jeunes entrepreneurs français dans le cadre de la plateforme Up-Afrique dont il est membre fondateur. Cette plateforme rassemble 10 jeunes entrepreneurs français de l’économie verte actifs sur le continent et vise à redynamiser les relations franco-africaines sur la base de l’entrepreneuriat, du secteur privé et des produits et services environnementaux.
Fabrice Le Saché est le fondateur et Directeur Général d’ecosur afrique, groupe spécialisé dans la finance climatique sur le continent africain. Diplômé en Droit International (LL.M San Diego School of Law, Université Paris II Panthéon-Assas), il crée à la fin de ses études, en 2006, la société ecosur spécialisée dans la finance et stratégie carbone en France. A partir de 2008, il engage un développement vers l’Afrique, marché alors considéré comme restreint pour les crédits carbone et fonde en 2009 ecosur afrique, groupe qui implantera des bureaux à Port-Louis, Abidjan, Kinshasa et Bruxelles. En quelques années, il constitue le 1er portefeuille de projets carbone d’Afrique (40 projets dans 17 pays), travaille avec des grands comptes continentaux (SIFCA, CSS, Géocoton, CIE, VRA, Hysacam, Zoomlion, Sococim,…) et les premiers acheteurs mondiaux de crédits carbone (Vitol, Cargill, Bunge, Shell Trading, Standard Bank, EDF Trading..). Le groupe devient le 1er négociant de crédits de carbone en Afrique subsaharienne et enregistre un nombre record de projets africains à l’ONU (25). En 2012, Fabrice Le Saché fonde ecosur investment, véhicule visant à acquérir des participations dans start-ups vertes africaines et ecosur trading afin de mieux valoriser les actifs carbone africains sur les marchés internationaux. Il est également à l’origine d’un plaidoyer visant à réorienter la finance carbone vers l’Afrique. L’initiative connue sous le nom de MDP-Afrique rassemble les signatures de 40 hauts dirigeants d’entreprises actifs sur le continent. Fabrice Le Saché s’investit également dans des actions de la société civile, notamment la mobilisation des jeunes entrepreneurs français dans le cadre de la plateforme Up-Afrique dont il est membre fondateur. Cette plateforme rassemble 10 jeunes entrepreneurs français de l’économie verte actifs sur le continent et vise à redynamiser les relations franco-africaines sur la base de l’entrepreneuriat, du secteur privé et des produits et services environnementaux.
VivAfrik